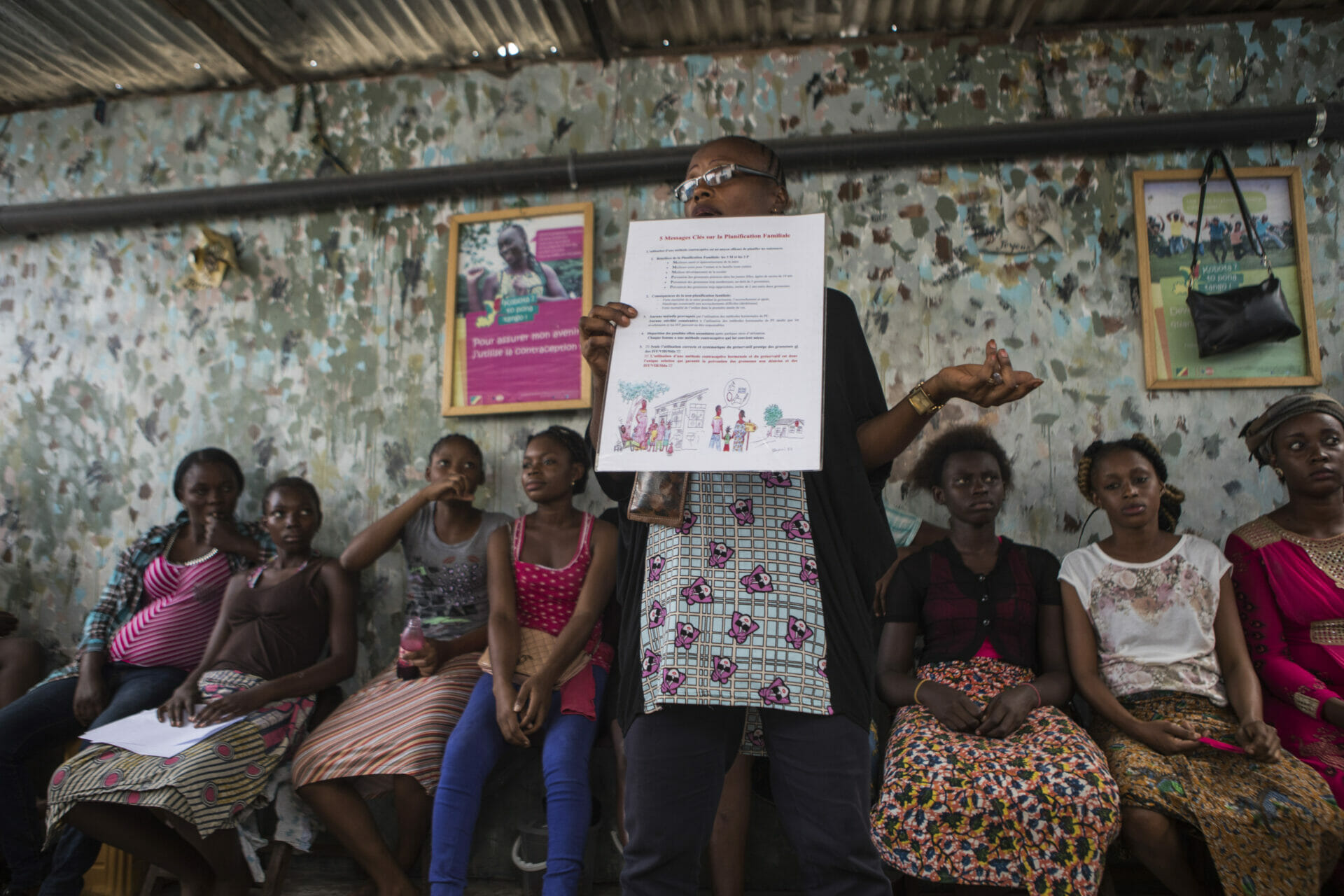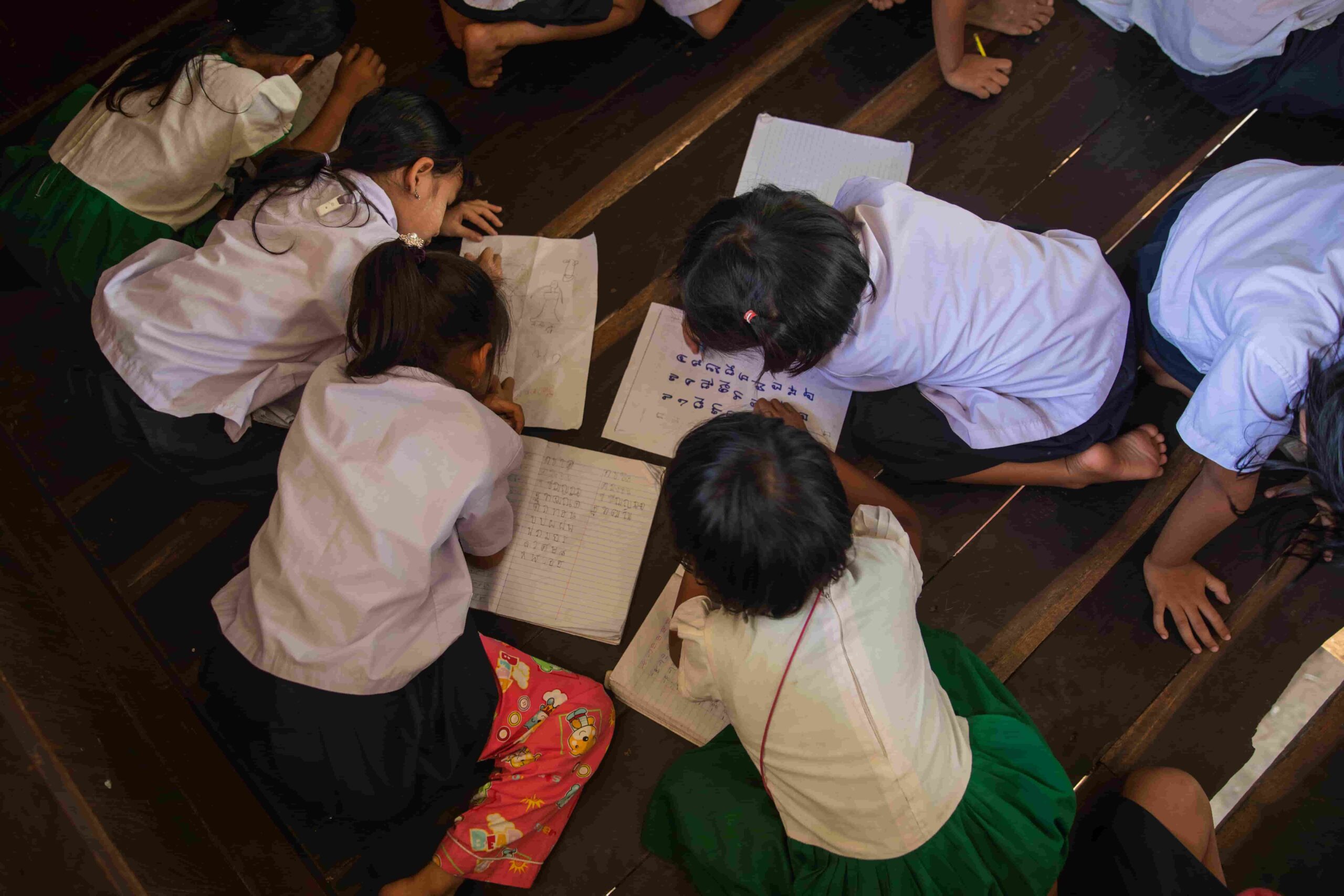Chemsex : un sixième symposium pour relever les défis
En novembre 2024, Bangkok a accueilli le sixième symposium Asie-Pacifique sur le chemsex (APCS). L’événement, coorganisé par l’Institut thaïlandais de recherche et d’innovation sur le VIH (IHRI), coordonné par la directrice exécutive de l’institut, la docteure Nittaya Phanuphak. Rendez-vous régional incontournable, le symposium propose un espace de dialogue sur les enjeux liés au chemsex. Chercheurs, soignants, militants et décideurs s’y sont retrouvés autour du thème de cette édition « Plaisirs, politiques, possibles », pour réfléchir aux réponses à apporter à ce phénomène complexe. La docteure Nittaya Phanuphak revient sur cet événement et les principaux défis liés au chemsex.
Quels étaient les principaux objectifs de cette sixième édition du symposium Asie-Pacifique sur le chemsex ?
Docteure Nittaya Phanuphak : Avec le soutien de L’Initiative, ce symposium visait d’abord à sensibiliser les soignants et communautés à travers la région Asie-Pacifique sur les défis liés au chemsex. Ce phénomène, en forte progression, concerne désormais bien au-delà des cercles spécialisés dans le VIH, la santé sexuelle ou les populations clés. C’est un défi transversal que plus personne ne peut ignorer.
L’autre ambition était d’outiller les participants — professionnels de santé et membres des communautés — pour leur permettre de mieux appréhender les réalités multiples du chemsex. Car le terme même de « chemsex » diffère selon les pays, les groupes concernés, et les substances impliquées. La première étape est donc de construire un langage commun, afin de faciliter la coopération régionale et le partage d’expériences.
Le symposium a aussi mis à l’honneur des initiatives sensibles aux contextes sociaux et politiques variés de la région, pour une réponse plus juste, mieux ancrée, et réellement efficace.
Deux ateliers majeurs ont rythmé l’événement : l’un dédié aux soignants, l’autre aux membres des communautés. Cette double approche est essentielle. Les professionnels de santé ont ainsi pu explorer les enjeux au-delà du strict cadre médical, confronter leurs pratiques et entendre directement les voix des concernés.
Les membres des communautés, quant à eux, ont pu exprimer leurs vécus, leurs frustrations et leurs espoirs — notamment autour de la stigmatisation et des discriminations croisées. Car nombre d’entre eux vivent à l’intersection de plusieurs vulnérabilités : orientation sexuelle, personnes vivant avec le VIH, usagers de substances en contexte sexuel, ou travailleurs du sexe.

Le thème de cette édition était « Plaisirs, Possibles et Politiques ». Que recouvrent ces trois mots ?
Docteure Nittaya Phanuphak : Ces trois piliers ont guidé la programmation du symposium. L’idée était de déplacer le regard, au-delà des discours classiques sur les risques. Le chemsex est aussi une recherche de plaisir. Comprendre cette dimension est indispensable pour construire des actions pertinentes, qu’il s’agisse de prévention ou de réduction des risques. Parmi les interventions marquantes, une personne venue de Singapour a justement exploré la manière dont le plaisir se vit et s’exprime dans les pratiques de chemsex. C’est là que se jouent les « Possibles » : inventer de nouveaux cadres d’action, sortir d’une logique sanitaire centrée uniquement sur l’arrêt des drogues plutôt que la réduction des risques. Quant aux « Politiques », c’est le maillon faible dans les débats autour du chemsex et des usages de substances. Peu de décideurs politiques, de juristes ou de représentants des forces de l’ordre participent à ce type de rencontre, alors qu’ils ont un rôle central à jouer. Lors du symposium, une avocate est revenue sur les effets positifs de la décriminalisation en Thaïlande, qui a permis de réduire le nombre d’incarcérations — tout en alertant sur les évolutions récentes de la loi, qui pourraient annuler ces avancées.
Le chemsex semble en forte progression dans la région. Qu’en est-il notamment en Thaïlande ?
Docteure Nittaya Phanuphak : Il est encore difficile d’avoir une vision complète du phénomène, comme les données manquent et les définitions varient. Le terme « chemsex », né à Londres pour désigner certaines pratiques sexuelles sous substances comme la métamphétamine (crystal meth), ne reflète pas toujours les réalités locales. Il est parfois plus pertinent de parler d’« usage de substances en contexte sexuel ».
En Thaïlande, des données relativement anciennes évoquent une prévalence de 17 à 18 % chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, mais des études plus récentes — bien que menées à plus petite échelle, chez les personnes vivant avec le VIH récemment diagnostiquées — laissent penser que ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 50 %. Les substances consommées, comme les pratiques, varient énormément. Certaines situations impliquent des pratiques à haut risque qui nécessitent un accompagnement important, d’autres sont moins préoccupantes. Ce qui est clair en revanche, c’est que le phénomène est courant et que les services doivent s’adapter.
Sur le terrain, nous mettons l’accent sur des approches inclusives, adaptées aux jeunes et sensibles au genre, sans chercher à les segmenter de genres, qui ne reflètent pas forcément leurs identités. Mais atteindre les jeunes sur le sujet du chemsex reste complexe. Même après avoir abaissé l’âge de participation à nos recherches à 16 ans, nous avons constaté une faible mobilisation. Le chemsex demande souvent une certaine autonomie financière, ce qui peut en partie expliquer cette difficulté. L’édition précédente de l’APCS n’avait pas de session spécifique dédiée aux jeunes, mais cette question est en discussion pour les prochaines rencontres, notamment à Kuala Lumpur.

Asie-Pacifique dédié au chemsex.
Quels sont les principaux risques liés au chemsex que les actions de réduction des risques devraient cibler ?
Docteure Nittaya Phanuphak : Malgré des années de travail en Thaïlande autour de la réduction des risques — avec la distribution de seringues ou des campagnes de prévention —, les résultats ne suivaient pas : nous ne constations pas de baisse significative des infections au VIH ou à l’hépatite C, par exemple. C’est ce constat qui nous a poussés à élargir notre action dans le domaine des usages de substances. Nous avons donc plaidé pour un cadre de réduction des risques plus global, articulé autour de quatre grands axes : l’accompagnement ciblé selon les substances, avec des actions d’éducation sur les drogues, de prévention des overdoses, et la fourniture de seringues et d’aiguilles ; des services de santé sexuelle, qui sont déjà bien établis en Thaïlande, avec un accès au dépistage du VIH, à la PrEP, aux préservatifs, ainsi que des services de plus en plus inclusifs, avec une approche d’affirmation de genre, et une prise en charge des mères usagères de drogues ; la santé mentale : nous formons désormais les soignants de première ligne et les travailleurs communautaires pour qu’ils puissent repérer les troubles, proposer une écoute, un accompagnement ou une mise en sécurité en cas d’idées suicidaires ; le soutien juridique et social, qui ressort comme la priorité numéro un exprimée par les usagers de substances en Thaïlande. Dans le pays, les pratiques policières restent très intrusives : tests urinaires sur le bord de la route, fouilles abusives… et de nombreuses personnes ignorent leurs droits. Leur donner accès à des informations juridiques et à un soutien adapté est indispensable.
En tant que directrice exécutive de l’IHRI, quelles sont les missions prioritaires sur lesquelles vous travaillez ?
Docteure Nittaya Phanuphak : Notre mission porte sur la recherche, le renforcement des capacités et le plaidoyer politique. Sur le plan de la recherche, nous avons participé à des essais cliniques, notamment sur la PrEP injectable à longue durée d’action, et collaborons avec les différents acteurs pour que ces innovations soient réellement accessibles en Thaïlande, au-delà des essais. Nous développons un modèle communautaire de réduction des risques, que nous étendons à d’autres sites et adaptons aux femmes transgenres, avec une approche d’affirmation de genre. En ce qui concerne le renforcement des capacités, nous avons formé des intervenants de terrain — travailleurs du sexe, personnes LGBTQ+ — pour offrir des services de dépistage ainsi que de réduction des risques. Enfin, nous plaidons pour intégrer ces services dans la couverture santé universelle en Thaïlande, même si les programmes de distribution des seringues restent un sujet sensible.
Je souhaite préciser que tout ce travail et ces avancées sont menacés par des coupes budgétaires importantes, notamment du gouvernement des États-Unis et d’autres bailleurs. Les organisations de la société civile font ce qu’elles peuvent pour s’adapter et survivre, mais elles ne doivent pas porter ce combat seules : les gouvernements doivent aussi agir et appuyer leurs partenaires de la société civile.